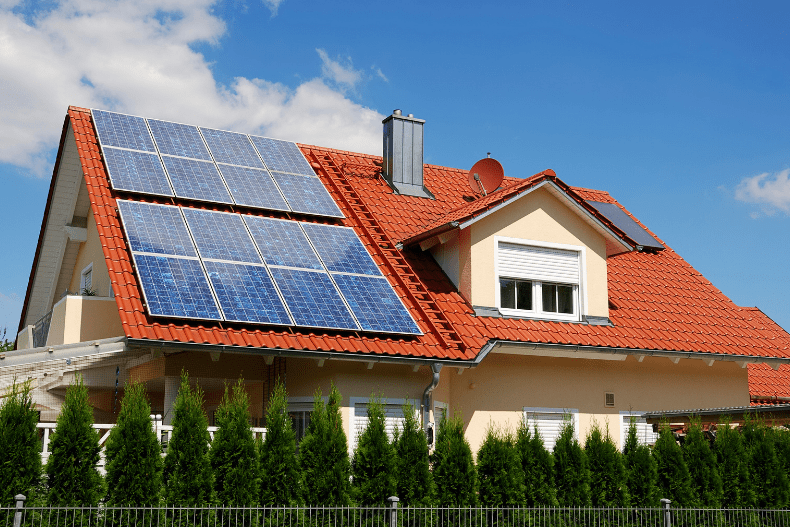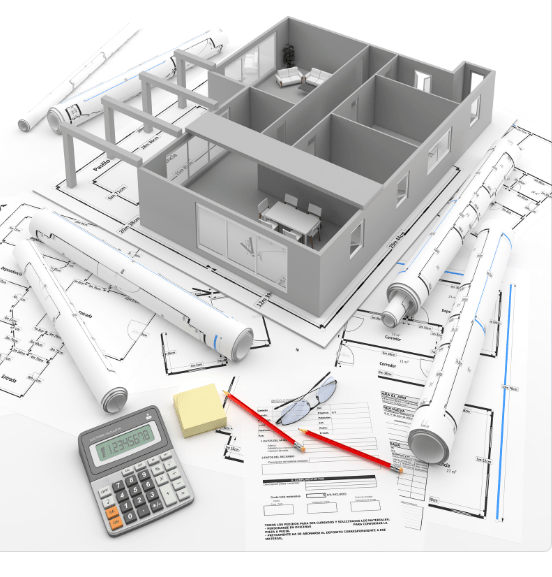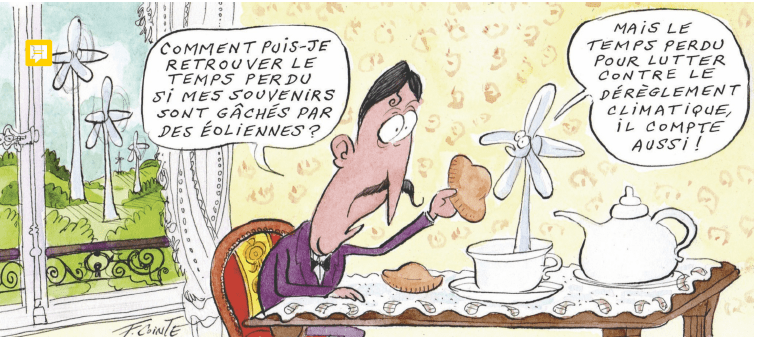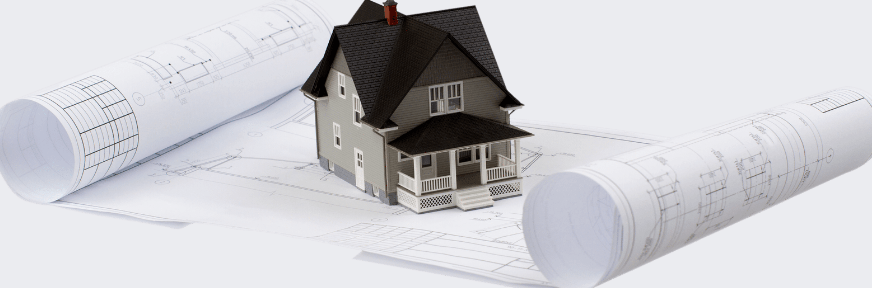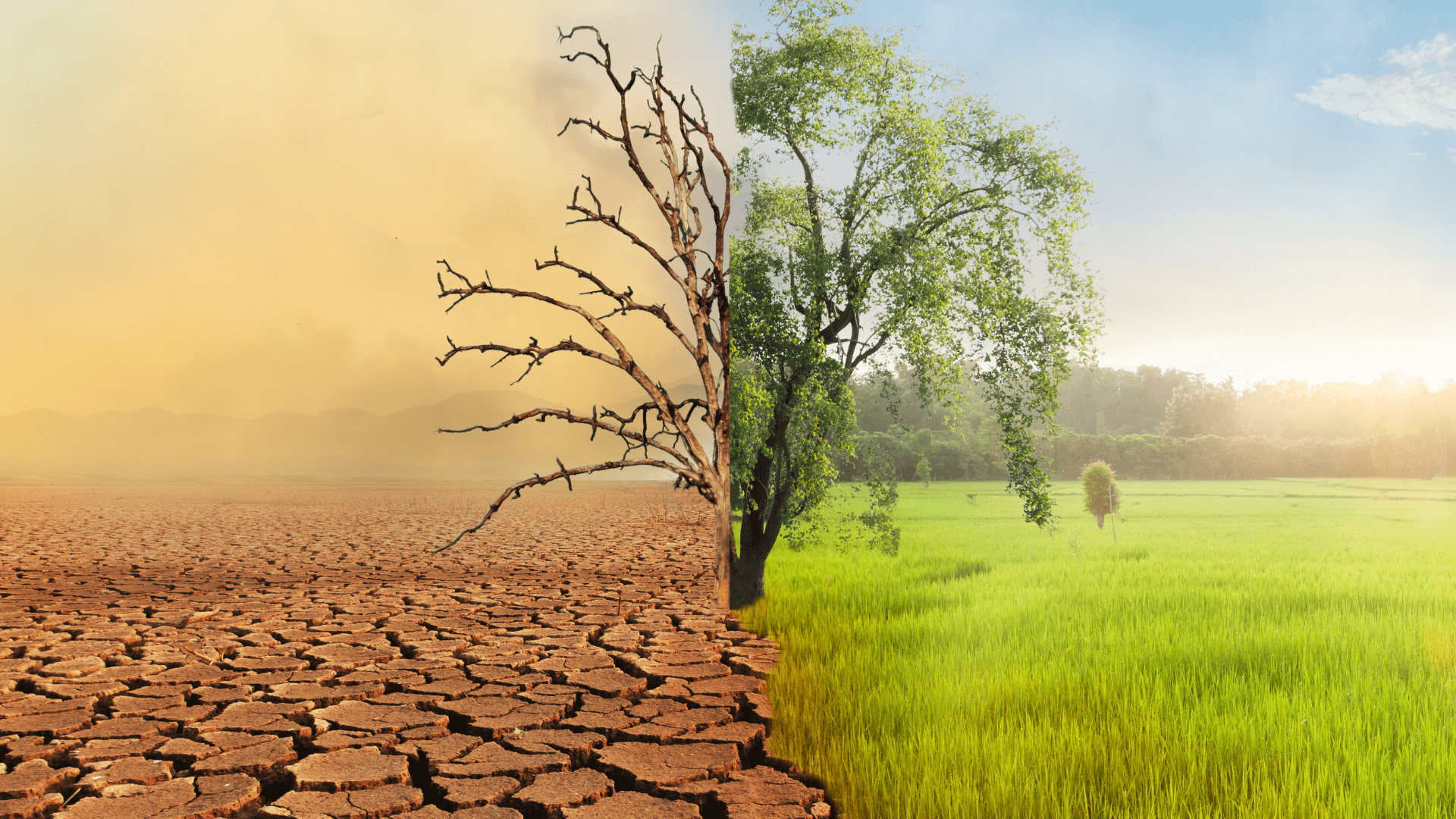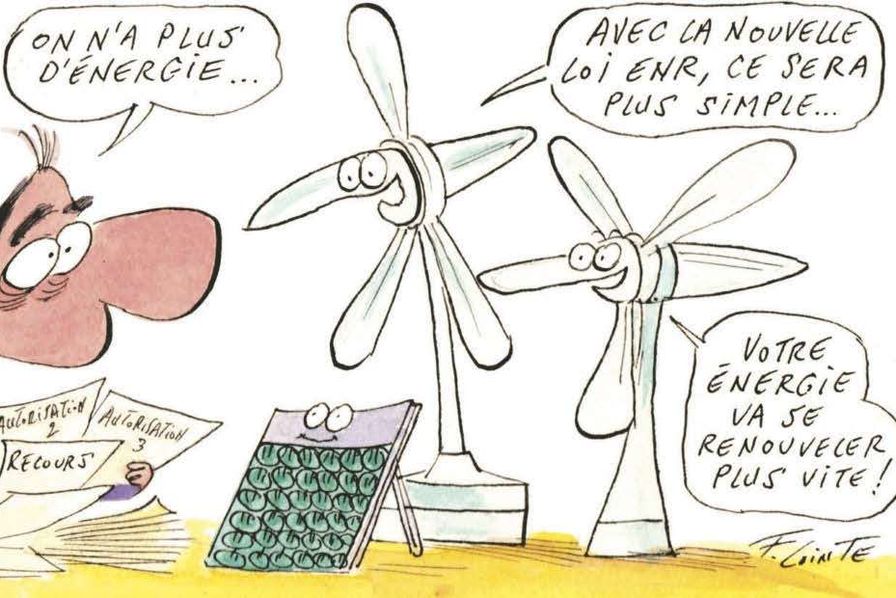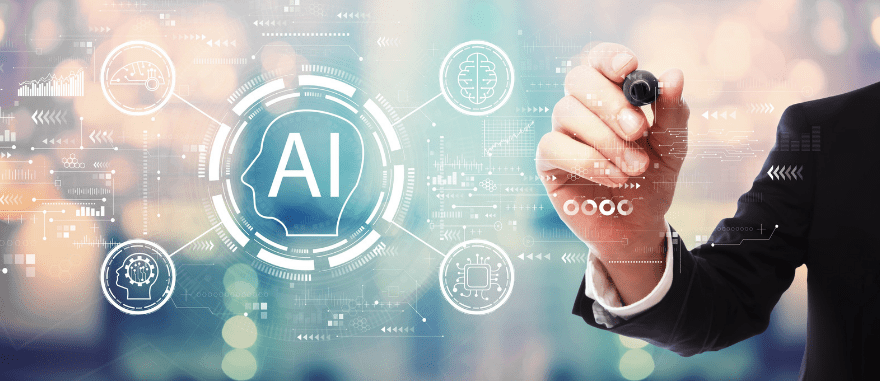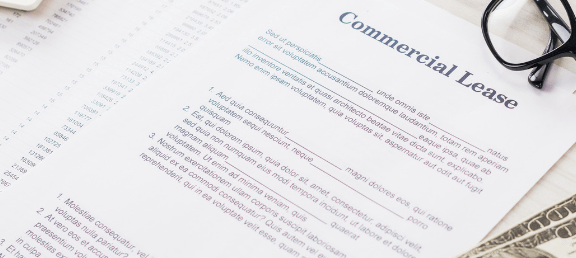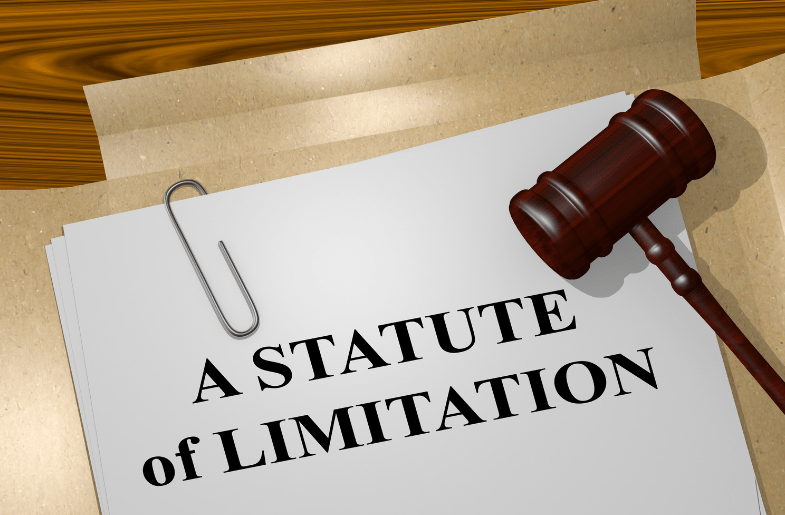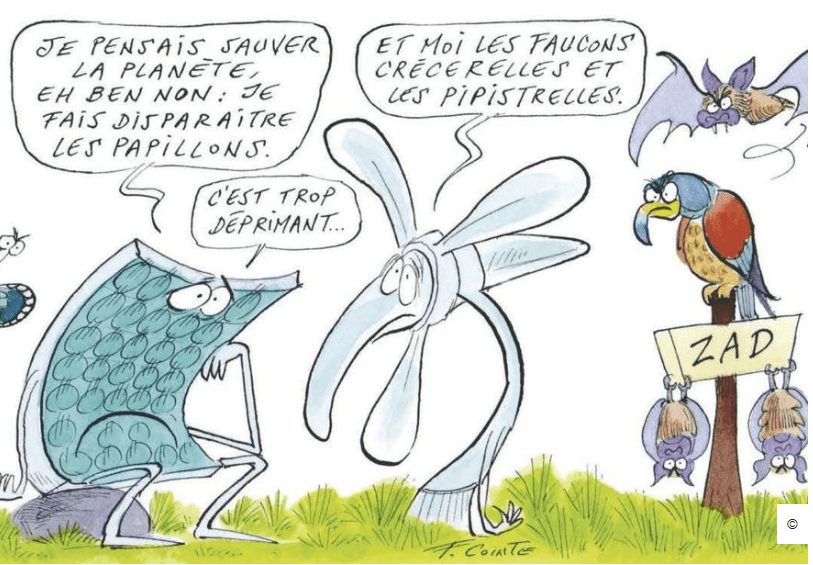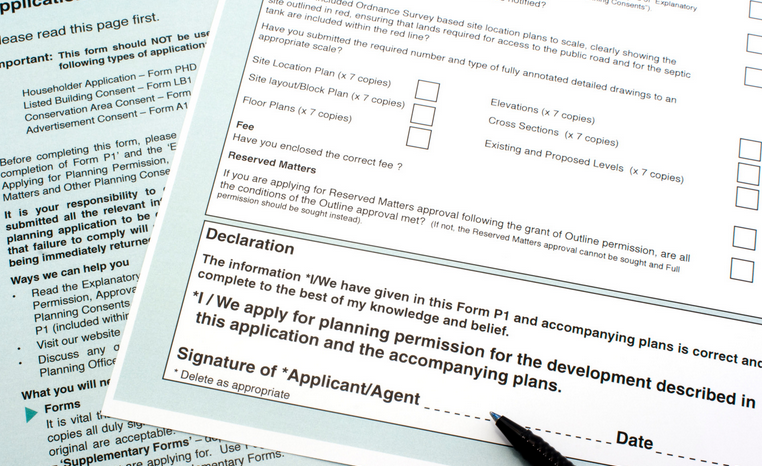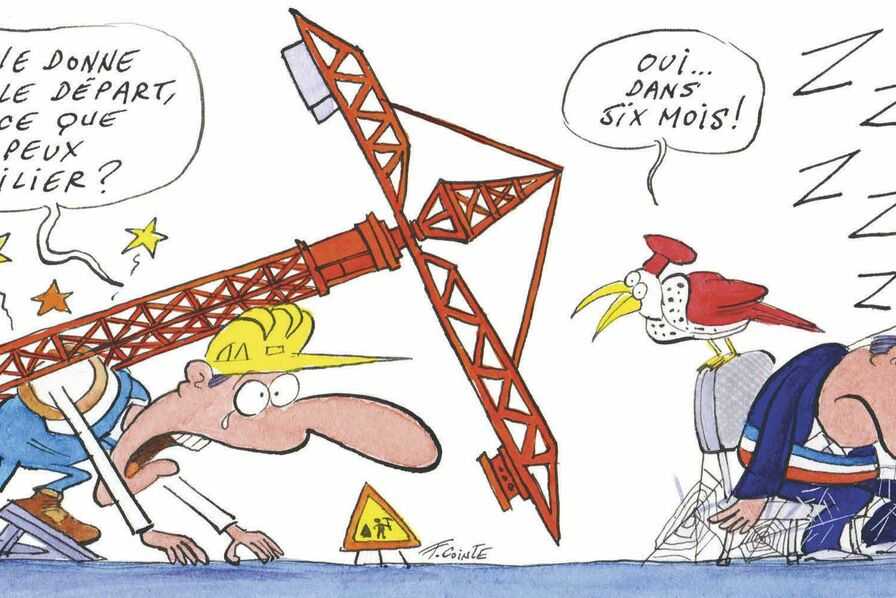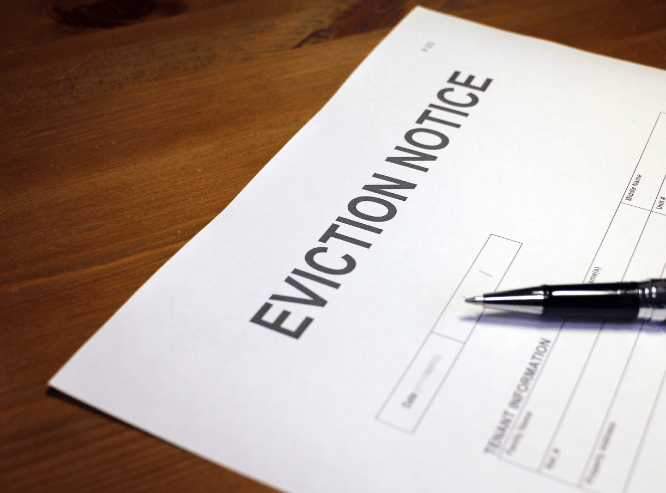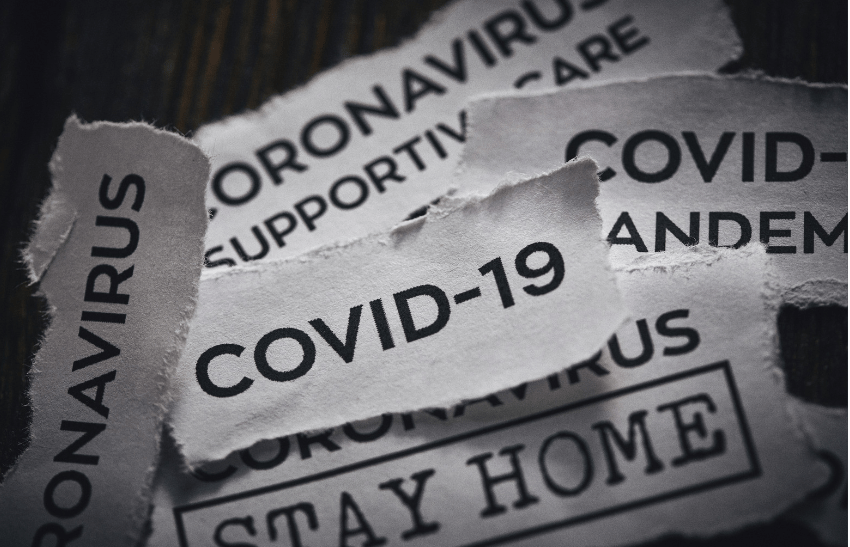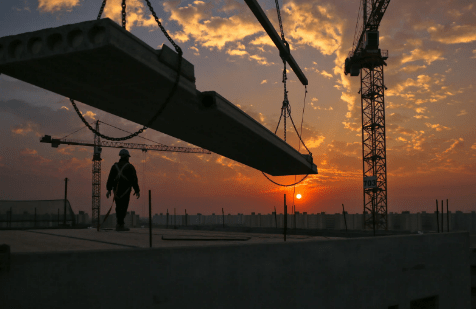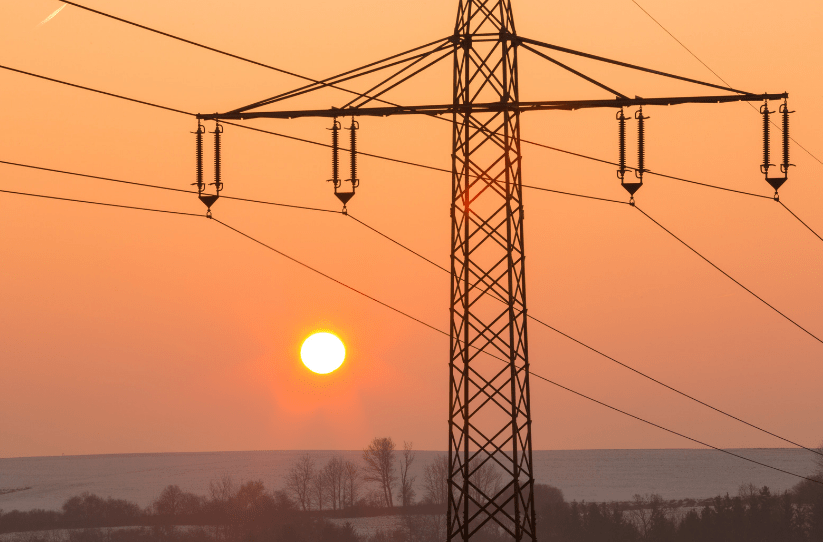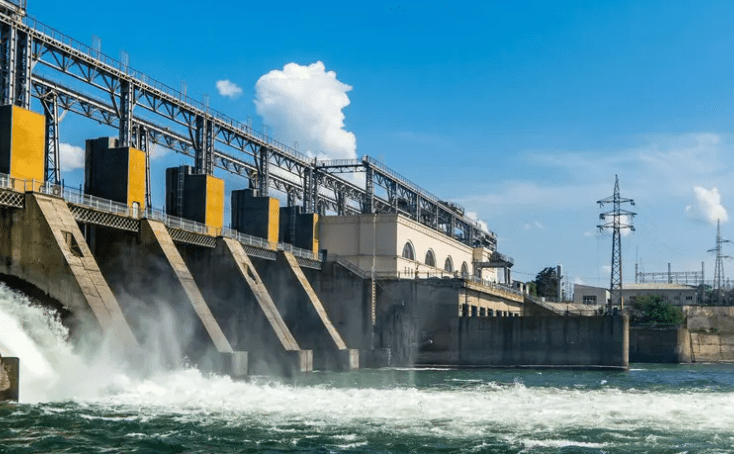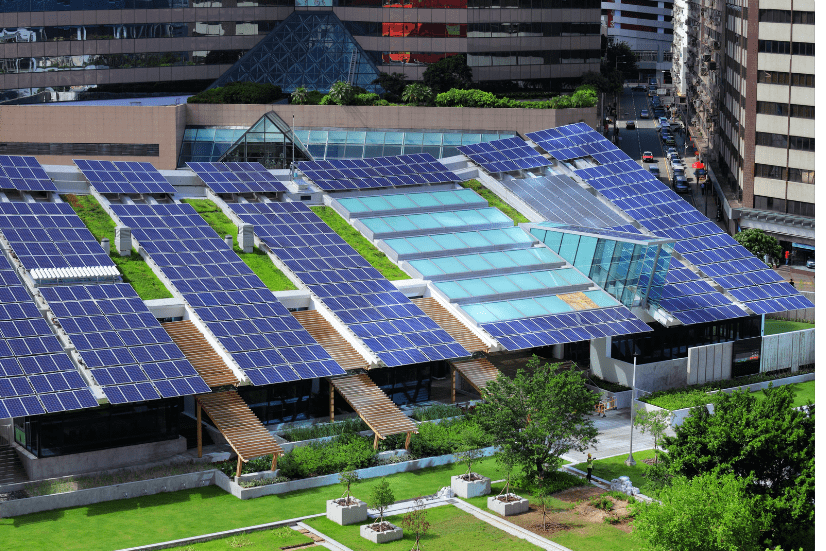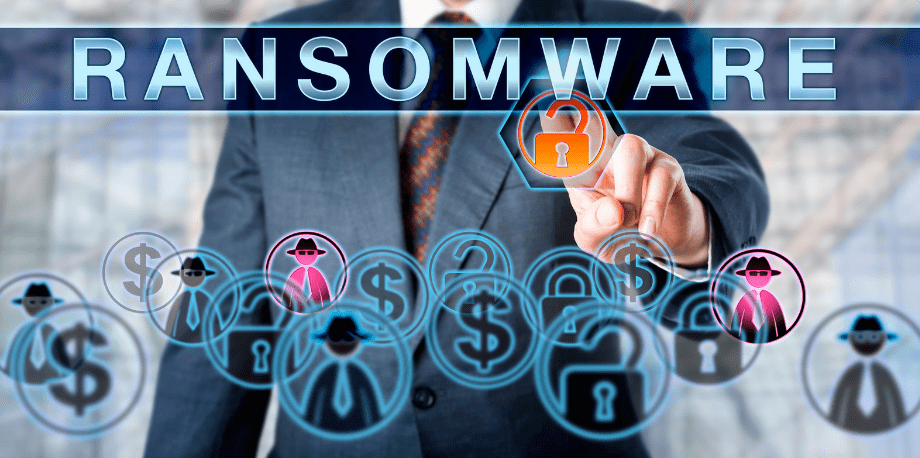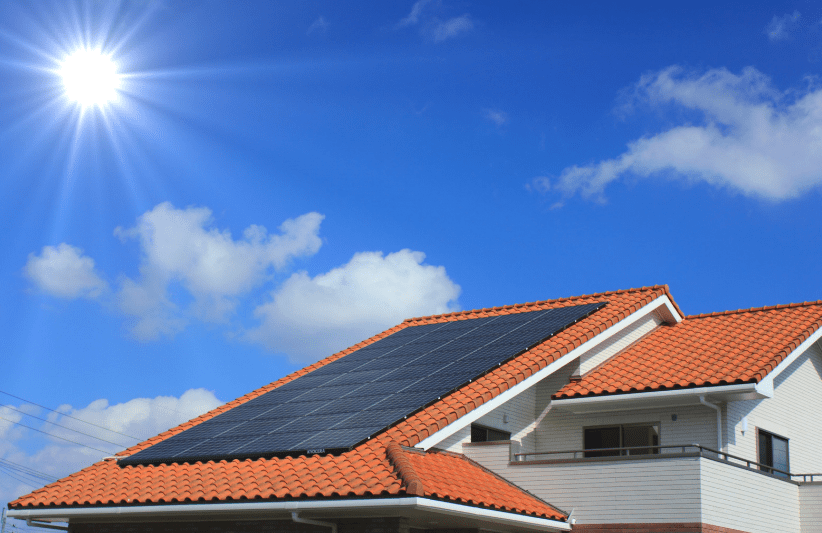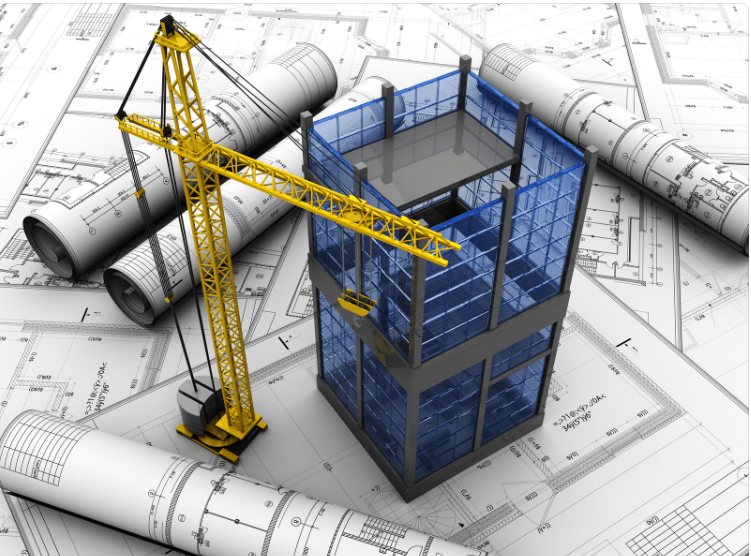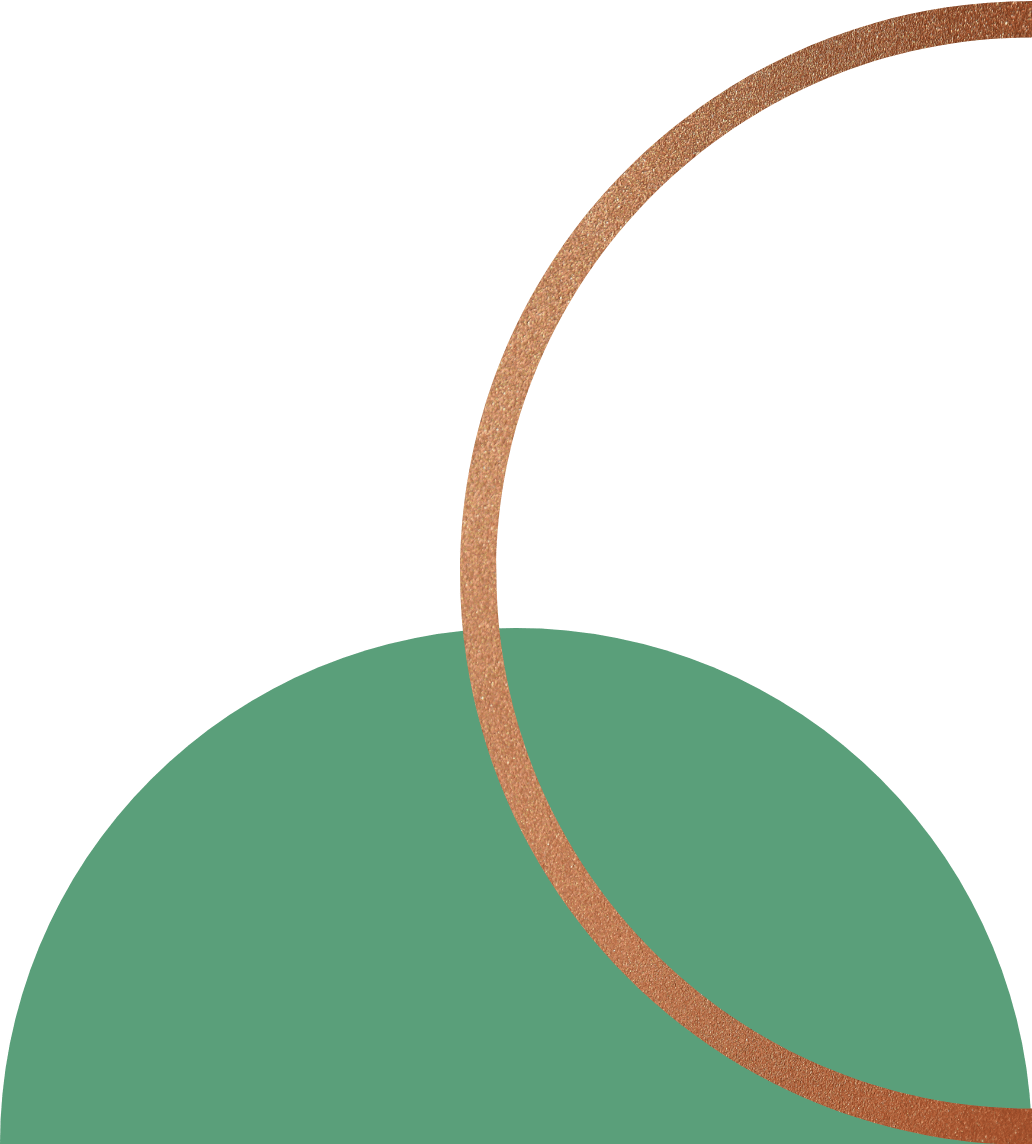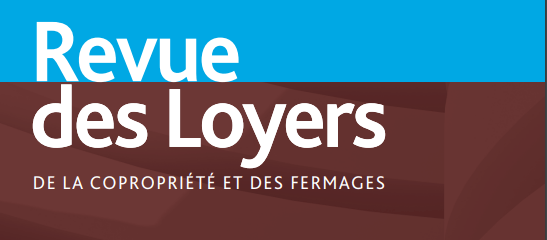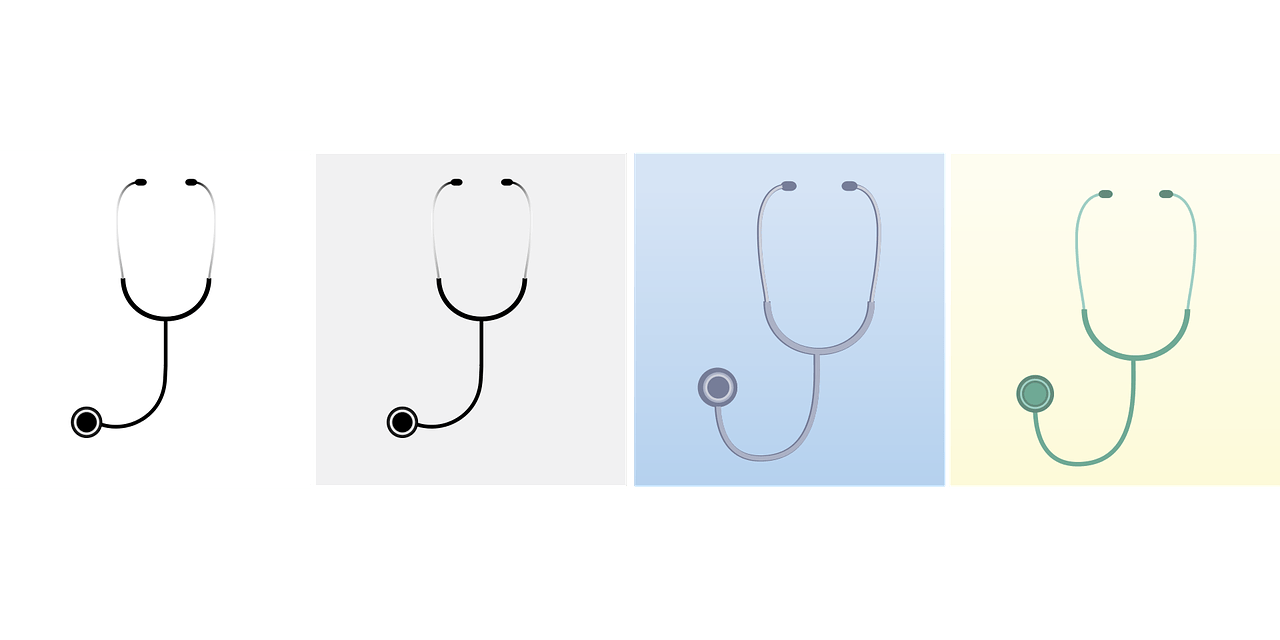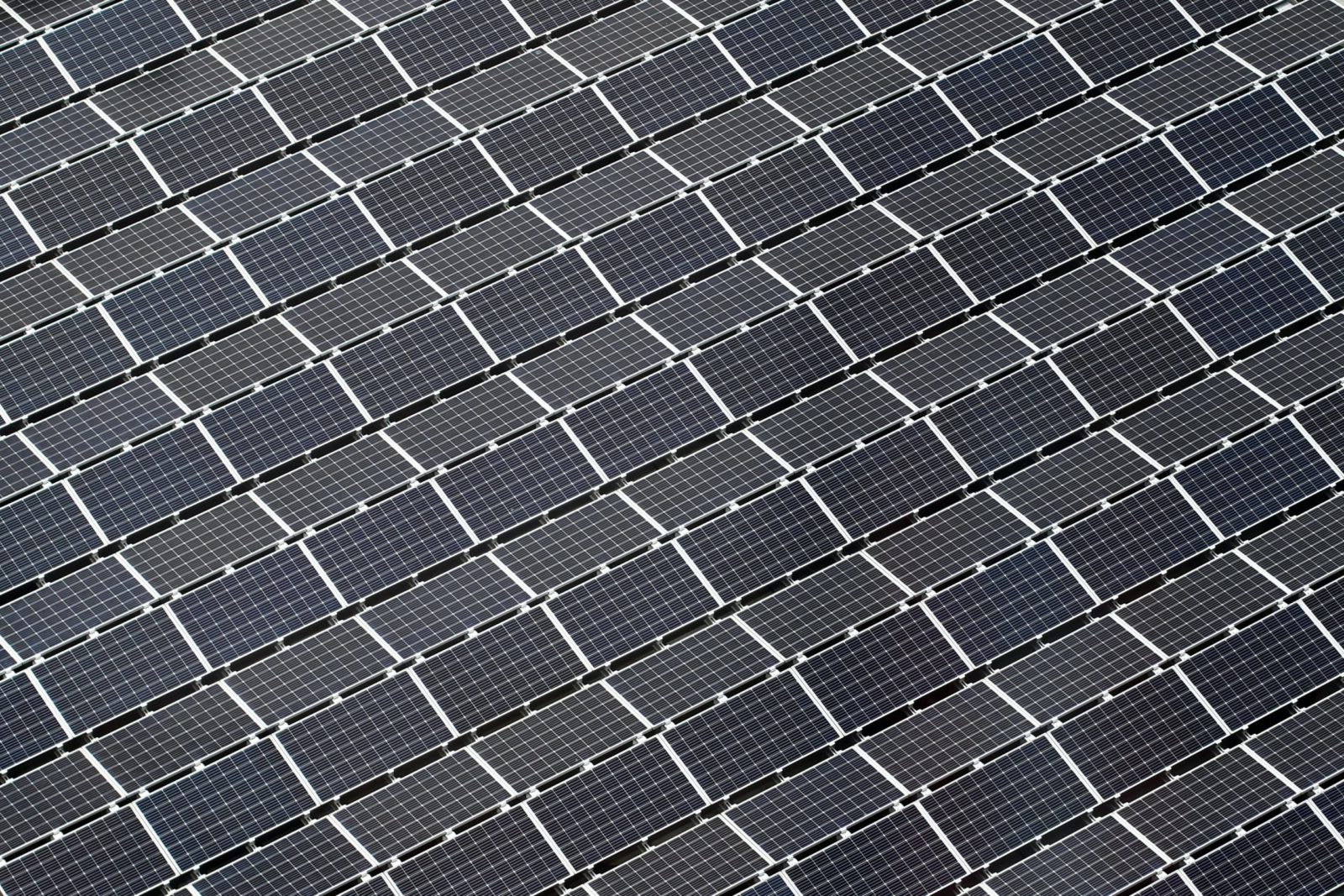La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite loi Pinel[1], a instauré un droit de préemption au profit du locataire dont les contours continuent de susciter un contentieux important. Dans le prolongement de notre précédent article paru en novembre 2017[2], il semblait utile de faire un nouveau point d’étape sur les dernières évolutions de la jurisprudence.
La nouveauté majeure est constituée par l’arrêt du 28 juin 2018[3], par lequel la Cour de cassation a considéré que le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce est un dispositif d’ordre public. Cette position de la Cour de cassation est d’autant plus notable que l’article L. 145-46-1 du Code de commerce ne figure pas à l’article L. 145-15 du Code de commerce (qui liste les dispositions d’ordre public).
Il convient toutefois de souligner qu’un auteur avait, dès la promulgation de la loi Pinel, considéré que la logique de ce droit de préemption conduisait à le considérer comme une « règle contraignante », insusceptible d’être « écarté ou aménagé par le bail »[4].
Le caractère d’ordre public du droit de préemption étant désormais tranché, il convient d’envisager les points qui restent en suspens, à savoir, d’une part, le champ d’application du droit de préemption (I) et, d’autre part, les conditions de sa mise en œuvre (II).
I – CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE préemption
A/ Le sort des bureaux commerciaux
Le sort des bureaux commerciaux a été évoqué par deux récents arrêts de cour d’appel.
En effet, par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 11 janvier 2022[5], ainsi que par un arrêt du 1er décembre 2021 de la Cour d’appel de Paris[6], les juridictions ont considéré que les baux portant sur les bureaux commerciaux entraient dans le champ d’application du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
À cet égard, la Cour d’appel de Paris précise que : « Les locaux usage de bureaux ne sont ni inclus expressément ni exclus expressément du champ d’application de ce texte et il est inopérant pour […] de se prévaloir du rejet de l’amendement n° 148 visant à étendre ces dispositions aux locaux à usage de bureaux dès lors que cet amendement ne visait que les bureaux de professionnels non commerçants pratiquant une activité libérale [7]».
La Cour d’appel de Paris considère en outre, à l’instar de la Cour d’appel de Rennes, que même si les locaux sont à usage exclusif de bureaux, ces bureaux sont loués dans le cadre d’une activité commerciale au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce et que le droit de préemption issu de la loi Pinel doit donc trouver à s’appliquer.
Il s’agit d’une précision qui n’était pas évidente, tant la doctrine avait considéré dans sa majorité[8], sur la base de l’amendement susvisé[9] qui avait été rejeté, qu’il était possible de considérer que les bureaux étaient exclus du champ du droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
La position de la Cour de cassation sur ce point sera donc examinée avec attention par les praticiens.
B/ Le contour des exceptions
Le droit de préemption instauré par la loi Pinel prévoit différentes exceptions dont l’étendue continue d’interroger.
En effet, le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce n’est pas applicable lorsque la vente du local loué intervient dans les cinq exceptions suivantes :
- cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ;
- cession unique de locaux commerciaux distincts ;
- cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial ;
- cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ;
- cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
La loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (JO 22 février 2022), dite loi 3DS vient d’ajouter une sixième exception puisque le droit de préemption n’est pas applicable « lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code ».
En tout état de cause, les deux exceptions qui donnent lieu, en l’état, à un contentieux abondant sont les exceptions relatives à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux et à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts, raison pour laquelle nous les étudierons successivement.
1° – Cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux
La question qui se pose, dans le cadre des différentes décisions récemment rendues sur le fondement de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, porte sur l’appréhension et la définition même de l’immeuble.
Les juridictions s’attachent à vérifier si l’assiette du bail consenti au preneur correspond à l’assiette de l’immeuble dont la vente est envisagée, afin de déterminer si le droit de préemption légal doit être purgé.
Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre du 29 novembre 2021[10], la Cour a relevé qu’il résultait du bail commercial et du plan annexé à ce bail que les bailleurs n’avaient loué à leur locataire qu’une partie de la parcelle objet de la vente et que, dans ces conditions, il n’était pas nécessaire de purger le droit de préemption du locataire puisque la vente portait sur la parcelle de terrain, dans sa globalité.
Certains cas d’espèce soulèvent toutefois davantage de questions : c’est notamment le cas avec l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021[11].
Les faits dans le cadre de cette espèce sont assez inhabituels : l’immeuble en question portait sur des locaux à usage d’entrepôt, étant précisé toutefois que les combles étaient expressément exclus de l’assiette du bail commercial et qu’il était prévu que le bailleur avait la possibilité d’accéder à ces combles.
La vente envisagée par le bailleur portait en revanche sur l’immeuble dans sa globalité, en ce compris les combles. En outre, la promesse de vente conclue avec un tiers prévoyait une condition suspensive aux termes de laquelle il y avait lieu de purger le droit de préemption de la société locataire.
Le notaire a donc purgé le droit de préemption auprès de la société locataire, qui a accepté l’offre de vente. Par la suite, le notaire a toutefois refusé de passer la vente et la société locataire a assigné son bailleur afin de constater la réalisation de la vente de l’immeuble à son profit.
Dans son arrêt du 14 novembre 2019[12], la Cour d’appel de Versailles a débouté la société locataire de ses demandes en considérant que l’exception relative à la vente globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux était caractérisée. Pour ce faire, la Cour d’appel donne une interprétation libérale du texte légal :
« Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel que l’expression plurielle ̎des locaux commerciaux̎ ne peut s’interpréter comme exigeant qu’il y ait plusieurs locaux commerciaux, ce texte ayant pour objet précisément de permettre la cession globale d’un immeuble partiellement loué et d’exclure, en un tel cas, le droit de préemption du preneur commercial ».
Sur la base de ce raisonnement consistant à assimiler la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux à un immeuble partiellement loué, la Cour d’appel considère que la vente envisagée est une vente globale d’un immeuble partiellement loué dans la mesure où l’assiette du bail ne correspondait pas exactement à l’assiette de la vente (en raison du fait que les combles ont été exclus de l’assiette du bail, mais pas de la vente).
La Cour d’appel conclut que le droit de préemption a été notifié au preneur, à tort, de sorte que la vente n’est pas parfaite, malgré l’acceptation de la société locataire. Ce dernier point du raisonnement de la Cour d’appel est conforme à la jurisprudence relative au droit de préemption applicable en matière de baux d’habitation[13].
Quid toutefois concernant l’assimilation entre la cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux et la cession d’un immeuble partiellement loué ?
Dans le cadre de son arrêt du 30 juin 2021[14], la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire et approuvé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, sans se prononcer sur cette assimilation puisque la société locataire a tenté de formuler dans le cadre de son pourvoi un moyen nouveau, irrecevable au stade de la cassation.
2°- Cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts
- Sur la notion de cession unique
Une cession unique de locaux commerciaux distincts peut porter sur des locaux situés dans le même immeuble : c’est l’enseignement de l’arrêt du 17 mars 2021[15] de la Cour d’appel de Paris.
En l’espèce, le bailleur avait consenti à un locataire un bail commercial portant sur une boutique et un appartement, ainsi qu’un autre bail commercial à une société, portant sur une boutique et deux appartements dans le même immeuble.
La société locataire soutenait que cette exception relative à la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était applicable que si les deux locaux commerciaux étaient situés dans deux immeubles distincts.
La Cour d’appel a répondu qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter au texte, qui était clair, et que, en l’espèce, les deux locaux commerciaux pouvaient être situés dans le même immeuble, puisque rien ne s’opposait à cela, en application de l’interprétation littérale de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce[16].
- Sur l’acte à régulariser en cas de cession unique
La vente de plusieurs locaux commerciaux distincts peut intervenir via deux actes distincts, d’après un arrêt du 14 janvier 2021[17] de la Cour d’appel d’Amiens.
Il s’agissait en l’espèce de la vente de deux immeubles situés dans deux villes distinctes (Narbonne et Amiens). Leur vente a été réitérée le même jour, par deux actes authentiques distincts. La société locataire occupant mono locataire d’un des deux immeubles, demandait la nullité de la vente de l’immeuble dont il était locataire, au motif que la cession unique de locaux commerciaux distincts n’était pas caractérisée et que le bailleur aurait conclu cette vente dans le seul but de le priver de son droit de préemption légal.
La Cour d’appel d’Amiens a débouté la société locataire en relevant que la vente des locaux commerciaux distincts était intervenue dans le cadre de la vente d’un portefeuille et que les notaires avaient effectué deux actes distincts « pour les besoins pratiques de la publicité foncière »[18].
- Sur la notion de locaux commerciaux
Le règlement de copropriété ayant une valeur contractuelle : il convient donc de retenir la qualification des locaux figurant au règlement de copropriété afin de déterminer s’il s’agit de locaux commerciaux.
C’est pourquoi, par un arrêt du 15 novembre 2018[19], la Cour de cassation a considéré que si le règlement de copropriété qualifie les locaux pris à bail de logement, ce lot ne peut pas constituer un local commercial distinct, au sens de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce susvisé.
Il s’agissait en l’espèce d’une vente portant sur deux locaux, le bailleur prétendant qu’il s’agissait de deux locaux commerciaux distincts. Le locataire s’est opposé à cette définition, considérant que l’un des locaux était en réalité un logement et que dès lors, le bailleur ne pouvait pas revendiquer l’existence de l’exception relative à la cession de plusieurs locaux commerciaux distincts et qu’il était dans l’obligation de purger le droit de préemption auprès de son locataire.
II – SUR LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE PRÉEMPTION
A / Sur les frais et commissions d’agence immobilière
Dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption, quel est le sort réservé aux frais et commissions d’agence immobilière ?
Cette question a notamment été tranchée par un arrêt du 12 janvier 2017[20] de la Cour d’appel de Douai, confirmé par l’arrêt précité de la Cour de cassation du 28 juin 2018[21] : l’offre de vente faite au preneur dans le cadre du droit de préemption légal ne saurait inclure les honoraires de négociation.
C’est la raison pour laquelle nous recommandions[22] d’apporter un soin particulier à la rédaction des mandats de vente en précisant le sort des frais d’agence en cas d’exercice par le locataire de son droit de préemption légal.
B / Sur la coexistence entre le droit de préemption légal et un droit de préférence contractuel
Le droit de préemption issu de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce peut parfaitement coexister avec un droit de préférence contractuel.
En revanche, il convient d’examiner successivement si l’opération envisagée par le bailleur est susceptible de relever du champ d’application du droit de préemption légal ou du droit de préférence contractuel, comme l’a relevé la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 18 mars 2021[23].
En l’espèce, le droit de préemption légal n’était pas applicable dans la mesure où il s’agissait d’une cession globale d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux.
Le bailleur avait tout de même l’obligation de purger le droit de préférence contractuel prévu au bail, ce qu’il fit en proposant à son locataire l’immeuble dans son ensemble, tout en visant néanmoins l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. La société locataire accepte d’acquérir l’immeuble, au prix de vente proposé par le bailleur, mais sans les honoraires de l’agent immobilier, comme c’est la règle en matière de droit de préemption légal…
La Cour d’appel écarte cependant l’argumentaire du locataire : le fait pour le bailleur de se tromper, en visant les dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dans le cadre purge de son droit de préférence contractuel, n’était pas de nature à ouvrir au locataire le droit de préemption légal.
En outre, dans le cadre du droit de préférence contractuel, le locataire était tenu, conformément aux dispositions de son bail, de régler la totalité du prix convenu avec le tiers, en ce compris la commission de l’agent immobilier.
Le preneur, qui a souhaité se porter acquéreur pour le montant du prix de l’immeuble, à l’exclusion des honoraires de l’agent immobilier, n’a pas valablement exercé son droit de préférence contractuel dont il était bénéficiaire en vertu des dispositions du bail, de sorte que la société locataire a été déboutée de sa demande visant à faire constater que la vente de l’immeuble était intervenue à son profit.
C / Sur la possibilité de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption légal du preneur
La rédaction de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce dispose, en son premier alinéa :
« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisagede vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente » (nous soulignons).
La question qui s’est rapidement posée était de savoir à quel moment la purge du droit de préemption légal pouvait valablement intervenir : en amont, avant tout échange avec un autre éventuel acquéreur, ou postérieurement ?
Sur la base d’une interprétation littérale de ce texte, il était en effet possible de s’interroger sur la chronologie applicable en matière de purge du droit de préemption légal[24].
Une réponse a été apportée sur ce point par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[25], confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du le 23 septembre 2021[26].
En l’espèce, une association propriétaire, qui envisageait de vendre un immeuble loué dans le cadre d’un bail consenti à un hôtel, avait préalablement mandaté une agence mobilière afin d’estimer la valeur locative de l’immeuble. Elle avait ensuite conclu une promesse de vente avec un tiers, sous réserve de la purge du droit de préemption légal du locataire.
La société locataire avait décidé de ne pas exercer son droit de préemption, mais avait toutefois contesté la régularité de l’offre de vente par courrier recommandé. Afin de pouvoir réitérer la promesse de vente conclue avec le tiers, l’association propriétaire décide d’assigner la société locataire aux fins de constater la purge de droit de préemption notifié à la société locataire.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2020[27], aux termes duquel la Cour d’appel a considéré que l’association avait régulièrement signifié à la société locataire une offre de vente de l’immeuble qui lui était loué et que cette offre n’a pas été acceptée par le preneur.
La Cour d’appel a toutefois rejeté la demande de l’association, tendant à voir juger que le droit de préemption du preneur était définitivement purgé.
En effet, rien n’empêche le propriétaire de conclure finalement le contrat de vente sous des conditions plus avantageuses, auquel cas une nouvelle purge de droit de préemption légal serait nécessaire, en application des dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.
La société locataire forme un pourvoi devant la Cour de cassation en considérant notamment que la bailleresse ne pouvait valablement pas mandater une agence immobilière et conclure une promesse de vente avec un tiers, avant d’avoir purgé le droit de préemption.
La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point dans le cadre d’un attendu de principe très clair : « la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, l’association avait pu confier à la société Immopolis un mandat de vente le 3 mars 2018, puis faire procéder à des visites du bien et que le fait qu’elle ait conclu, le 8 novembre 2018, une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente [28]».
Cet arrêt de la Cour de cassation détaille clairement ce que le bailleur peut réaliser comme démarches, en amont, avant de purger le droit de préemption légal, mettant ainsi fin aux précédentes interrogations de la doctrine.
Près de huit ans après la promulgation de la loi Pinel, les enseignements de la jurisprudence nous permettent enfin d’appréhender de manière plus précise le droit de préemption légal.
Affaire à suivre !
Notes de bas de pages
[1] L. n° 2014-626, 18 juin 2014, JO 19 juin, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
[2] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, Rev. loyers 2017/981, n° 2694.
[3] Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. civ. III, n° 76 : Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles, Rev. loyers 2018/990, n° 2947.
[4] Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, AJDI 2014, p. 595.
[5] CA Rennes, ch. 1, 11 janv. 2022, n° 20/01661.
[6] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194.
[7] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 1er déc. 2021, n° 20/00194, précité.
[8] Chaoui H., Droit de préemption de la loi Pinel : dernier état de la jurisprudence, précité ; V. également Planckeel Fr., Le nouveau droit de préemption du locataire commercial, précité.
[9] Projet de loi Sénat n° 441, amendement n° 148 rect., 16 avr. 2014.
[10] CA Basse-Terre, ch. civ. n° 2, 29 nov. 2021, n° 19/00418.
[11] Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.893.
[12] CA Versailles, 3e ch., 14 nov. 2019, n° 19/05033.
[13] Cass. 3e civ, 20 oct. 2010, n° 09-66.113, Bull. civ. III, n° 192.
[14] Toutefois, indépendamment de la définition de la notion « d’un immeuble comportant plusieurs locaux commerciaux », l’intérêt de cet arrêt réside également dans le fait que la Cour de cassation valide la possibilité pour le bailleur, lorsqu’il envisage de vendre le local commercial, de conclure une promesse de vente sous condition suspensive de la purge du droit de préemption du preneur (voir infra II).
[15] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232.
[16] « L’article L. 145-46-1 du Code de commerce énonce un principe et des exceptions.
Il est constant que les exceptions s’interprètent strictement et qu’on ne peut ajouter un texte clair.
En l’espèce, le texte étant clair, il n’y a pas à l’interpréter en recherchant l’intention du législateur au travers des travaux parlementaires. […]
Il est soutenu qu’il s’agit de la cession unique de locaux commerciaux distincts, figurant au titre des exceptions.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier Juge, on entend par cession unique une opération juridique globale constatée, comme en l’espèce en un seul acte. Sauf à ajouter au texte, il suffit que cette cession unique porte au moins sur deux locaux commerciaux. Le texte ne disposant pas que ces locaux doivent se situer dans des immeubles distincts, ou encore que l’exception serait inapplicable, si en sus des locaux distincts étaient vendus d’autres locaux non affectés au commerce » (CA Paris, pôle 5, ch. 3, 17 mars 2021, n° 19/10232, précité).
[17] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229.
[18] CA Amiens, ch. éco., 14 janv. 2021, n° 19/03229, précité.
[19] Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n° 17-26.727.
[20] CA Douai, ch. 2, sect. 1, 12 janv. 2017, n° 15/07384.
[21] Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, précité ; Voir Chaoui H., Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.
[22] Voir Chaoui H,. Le droit de préemption issu de la loi Pinel est désormais d’ordre public : point sur les dernières précisions jurisprudentielles,précité.
[23] CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/03890.
[24] Monéger J. et Lafond J., Le droit de préférence du locataire commerçant lorsque le bailleur envisage de vendre le local – Retour sur une question de chronologie, JCP N 2021, n° 1, 1003.
[25] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638.
[26] Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.799, publié au Bulletin, Rev. loyers 2021/1021, n° 3754, obs. Zalewski-Sicard V.
[27] CA Paris, pôle 5, ch. 3, 27 mai 2020, n° 19/09638, précité.
[28] La société locataire a également tenté de soutenir que l’association propriétaire ne pouvait pas viser dans l’offre de vente les frais de l’agent immobilier. Sur ce point encore, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société locataire en indiquant que« si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente »(Cass. 3e civ., 23 sept. 2021, n° 20-17.799, précité).
Source : Revue des loyers, 1025, 01-03-202
https://www.lamyline.fr/content/document.aspx?idd=DT0006407467&version=20220311