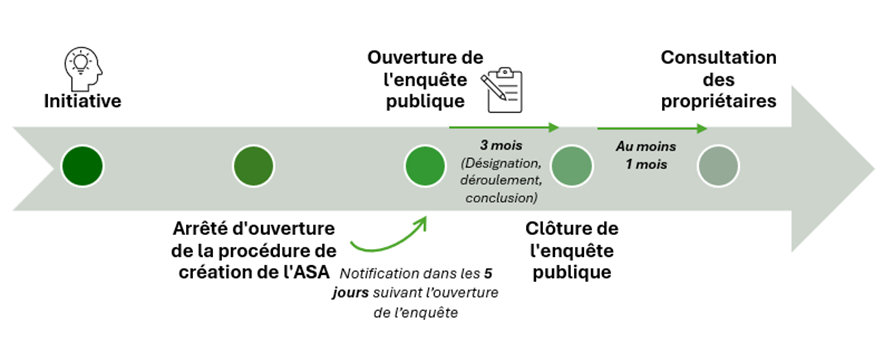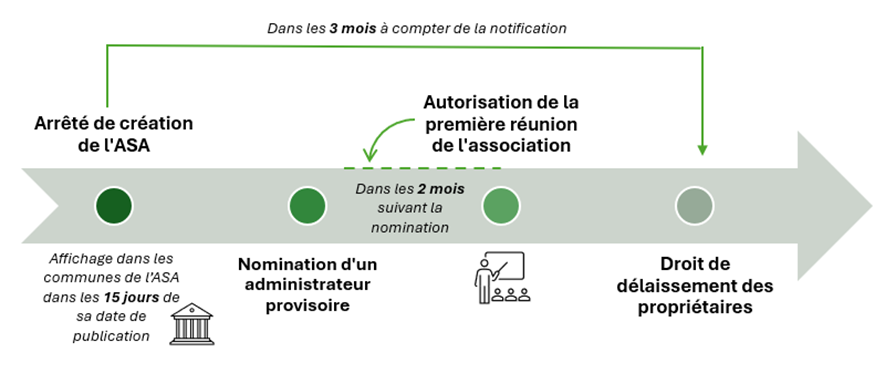Les candidats évincés d’une procédure de passation d’un marché public ou d’une concession peuvent :
- Agir rapidement avant la signature du contrat afin d’obtenir l’annulation de la procédure : via le fameux référé précontractuel
- Agir rapidement après la signature du contrat pour les mêmes fins : via le référé précontractuel
- Agir après la signature du contrat afin d’obtenir son annulation ou une indemnité. Ce recours pouvant être assorti dans les cas d’urgence d’un référé suspension du contrat.
1/ Le référé précontractuel avant la signature du contrat
Ce recours, codifié aux articles L. 551-1 et s. du CJA, vise les contrats de la commande publique. Il a pour objet de contester la procédure de passation en soulevant des moyens relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Qui peut saisir le juge ?
Après démonstration qu’ils sont lésés par le manquement invoqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence, il s’agit :
- Des candidats évincés, à tout stade de la procédure de passation ;
- Des candidats potentiels, c’est-à-dire ceux que les irrégularités de la procédure ont pu dissuader de présenter une offre.
Le préfet peut également intenter un tel recours.
Quels délais ?
Pour le requérant :
Le juge ne peut être saisi qu’avant la signature du contrat.
Si la signature intervient en cours d’instance, le recours devient sans objet (possibilité sous condition d’engager un référé contractuel).
La saisine du juge suspend automatiquement la procédure de passation.
Pour l’acheteur public :
La signature du contrat ne peut intervenir immédiatement après l’attribution. Un délai suspensif obligatoire doit être observé entre la notification de la décision d’attribution aux candidats évincés et la conclusion du marché.
Ce délai de suspension (dit « standstill ») s’impose en toute circonstance pour les concessions et pour les procédures formalisées s’agissant des marchés publics :
- 11 jours lorsque l’information a été transmise par voie électronique ;
- 16 jours lorsqu’elle a été adressée par un autre moyen (courrier postal, remise en main propre, etc.).
Pour le juge :
Le juge du référé précontractuel est tenu de statuer dans un délai maximal de 20 jours à compter de sa saisine.
Cependant, ce délai n’est pas extinctif : son dépassement n’a pas pour effet d’entraîner le dessaisissement du juge.
Quels sont les moyens invocables ?
Le référé précontractuel est strictement cantonné aux manquements commis par l’acheteur public à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre de la passation du contrat.
Peuvent ainsi être utilement invoqués des griefs relatifs à :
- La définition du besoin ou des prestations attendues ;
- Les modalités de publicité de la procédure ;
- La qualité et la transparence des informations fournies aux candidats ;
- Le respect des documents de la consultation, en particulier lors de l’analyse des offres au regard des critères annoncés ;
- Les motifs de rejet notifiés aux entreprises non retenues.
Mais la recevabilité du moyen ne suffit pas : encore faut-il que les manquements allégués aient été susceptibles d’avoir lésé ou risquent de léser l’entreprise.
Que sont les pouvoirs du juge ?
Dans le cadre du référé précontractuel, le juge administratif est investi de prérogatives étendues. Il peut notamment :
- Ordonner à l’acheteur public de se conformer à ses obligations légales ;
- Suspendre ou annuler toute décision prise dans le cadre de la procédure (comme le rejet d’une offre ou l’attribution du marché) ;
- Supprimer ou modifier des clauses destinées à figurer dans le contrat final.
Le juge dispose de pouvoirs d’injonction et de suspension. Le juge peut aller jusqu’à :
- Enjoindre de recommencer l’intégralité de la procédure ou de la reprendre à l’étape du manquement identifié ;
- Exiger la réintégration d’un candidat évincé dans la procédure ;
- Imposer la communication des motifs de rejet aux opérateurs économiques concernés.
2/ Le référé contractuel, après la signature du contrat
Codifié aux articles L. 551-13 et s. du CJA, ce recours intervient après la signature du contrat de la commande publique, afin de sanctionner les manquements graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Il constitue ainsi une « voie de rattrapage contentieuse », lorsque le juge du référé précontractuel n’a pas été saisi à temps à raison de la méconnaissance des règles procédurales.
Qui peut saisir le juge ?
Requérants identiques au référé précontractuel.
Un opérateur économique peut être recevable à former un référé contractuel lorsqu’il ne lui a pas été donné la possibilité d’exercer un référé précontractuel :
- Lorsque le candidat n’a pas été informé du rejet de son offre ni de la signature du contrat ;
- En procédure formalisée, lorsque le candidat n’a pas été informé du délai suspensif de signature du marché, dit délai de standstill ;
- En procédure adaptée, lorsque le candidat n’a pas été informé de l’intention de la personne publique de conclure le contrat.
Cette condition de non-recevabilité préalable du référé précontractuel fait du référé contractuel un recours subsidiaire.
Quels délais ?
Pour le requérant :
Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de :
- 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au Journal officiel de l’Union européenne ;
- Pour les accords-cadres, 31 jours également à compter de la notification de la conclusion du contrat ;
- 6 mois à compter du lendemain de la signature du contrat, en l’absence de toute publication d’un avis d’attribution ou de notification de sa conclusion.
Pour le juge :
Le juge dispose d’un délai d’un mois, à compter de sa saisine, pour statuer en matière de référé contractuel.
Quels sont les moyens invocables ?
Le référé contractuel a pour vocation de sanctionner les irrégularités les plus graves affectant la passation d’un marché public. Les moyens invocables y sont donc plus limités que dans le cadre du référé précontractuel.
Il appartient au juge de vérifier que les manquements invoqués par le candidat évincé ont affecté ses chances d’obtenir le contrat.
Quels sont les pouvoirs du juge ?
Le juge du référé contractuel dispose de pouvoirs particulièrement étendus pour sanctionner les irrégularités constatées. Il peut :
- Annuler le contrat dans son intégralité ;
- Prononcer sa résiliation ;
- Réduire sa durée ;
- Infliger une pénalité financière.
3/ Le recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn-Garonne »)
Par un arrêt du 4 avril 2014, « Département de Tarn-et-Garonne », le Conseil d’Etat consacre une nouvelle voie de droit permettant aux tiers, sans considération de leur qualité, de contester la validité du contrat.
Qui peut saisir le juge ?
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former ce recours.
Autrement dit, le recours peut être formé par tous les concurrents évincés ou par tous les tiers susceptibles d’être lésés dans ses intérêts de façon directe et certaine par la formation du contrat.
La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant justifiant d’un intérêt à conclure le contrat, même s’il n’a pas présenté sa candidature, s’il n’a pas été admis à soumettre une offre, ou s’il a proposé une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
Quels délais ?
Pour le requérant :
Le recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Quels sont les moyens invocables ?
Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l’intérêt lésé ou soient d’un gravité telle que le juge doit les relever d’office.
Quels sont les pouvoirs du juge ?
Le juge dispose de pouvoirs étendus, qu’il adapte en fonction de la nature du vice affectant le contrat ainsi que des impératifs liés à la sécurité juridique et à l’intérêt général, notamment la continuité du service public.
Ainsi, le juge peut :
- Décider de la poursuite de l’exécution du contrat ;
- Inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe ;
- Prononcer la résiliation du contrat, éventuellement avec un effet différé, après avoir vérifié que cette décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ;
- Annulation du contrat.
Saisi de conclusions tendant à ces fins, le juge peut également condamner les parties à verser une indemnité en réparation des droits lésés de l’auteur du recours.
À ce titre, le requérant a la possibilité :
- Soit de présenter des conclusions indemnitaires devant le juge du contrat, à titre accessoire ou complémentaire à ses demandes de résiliation ou d’annulation ;
- Soit d’engager un recours de pleine juridiction distinct, exclusivement destiné à obtenir une indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité du contrat dont il a été évincé.
La recevabilité de ces conclusions indemnitaires n’est pas soumise au délai de deux mois applicable au recours principal, mais elle dépend de l’intervention d’une décision administrative préalable de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance.
4/ Le référé suspension « Tarn-Garonne »
Le recours dit « Tarn-et-Garonne en contestation de la validité du contrat peut être assorti d’un référé suspension afin d’obtenir la suspension du contrat.
Les conditions pour obtenir cette suspension sont au nombre de 4 :
- L’introduction préalable d’un recours en contestation de la validité du contrat
- Le contrat contesté doit toujours être en cours d’exécution : s’il est entièrement exécuté, il n’y a plus rien à suspendre !…
- L’urgence à ce que cette suspension soit ordonnée. Le juge apprécie concrètement en fonction du contexte si l’exécution du contrat est de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution du contrat soit suspendue.
- L’existence d’un doute sérieux quant à la validité du contrat. Il s’agira ici pour le requérant de reprendre les arguments développés dans le cadre du recours en contestation de validité.
Exemples de décisions récentes rendues dans ces matières :
Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 15 juillet 2025, n° 2205367 : l’insuffisance d’information des élus, la méthode d’analyse des offres ou la rupture d’égalité entre candidats ne sont pas retenues comme motifs d’annulation ou de résiliation du contrat si la procédure a respecté les exigences de transparence, d’égalité de traitement et que les élus ont eu accès à une analyse complète des offres
Tribunal administratif de Bordeaux, 9 janvier 2025, n° 2407926 : Le juge du référé précontractuel est compétent pour contrôler le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, mais il ne peut pas se prononcer sur l’appréciation de la valeur technique d’une offre, ni sur des erreurs manifestes d’appréciation qui ne relèvent pas d’une dénaturation du contenu de l’offre. Ainsi, la contestation de la notation technique d’une offre est inopérante devant ce juge, sauf dénaturation manifeste
Notre expertise :
Notre cabinet intervient régulièrement dans le cadre de ces procédures. L’équipe d’avocats de Xavier Heymans, basée à Bordeaux en Gironde est rompue à ces contentieux dans lesquels elle intervient habituellement. En outre, elle conseille les acteurs pour sécuriser les procédures de passation (missions d’assistance à la passation des marchés publics et concessions) et les offres des candidats (missions d’assistance auprès des candidats). Elle assure également des formations ou intervient dans des colloques, tables rondes sur ces thèmes. Elle intervient sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Outre-Mer (surtout en Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte dont les tribunaux administratifs relèvent de la compétence de la Cour administrative d’appel de Bordeaux).