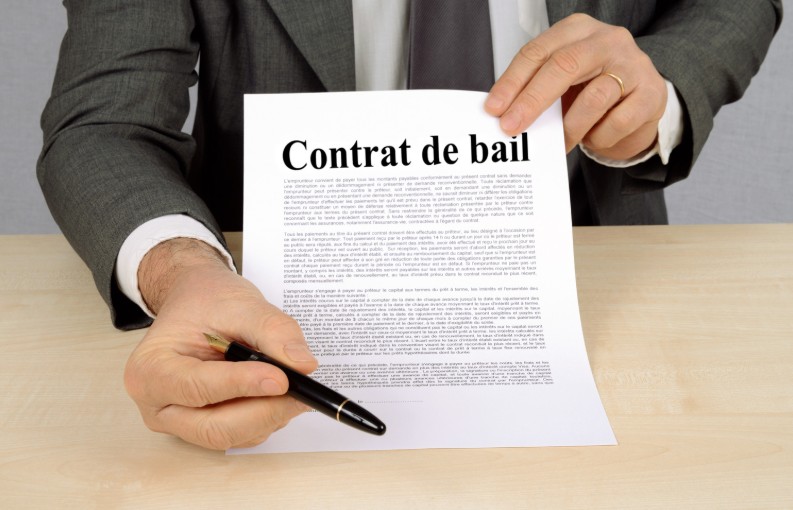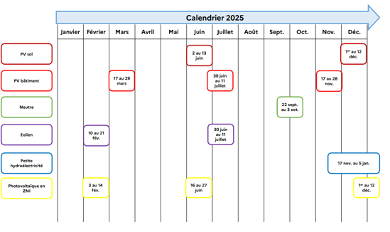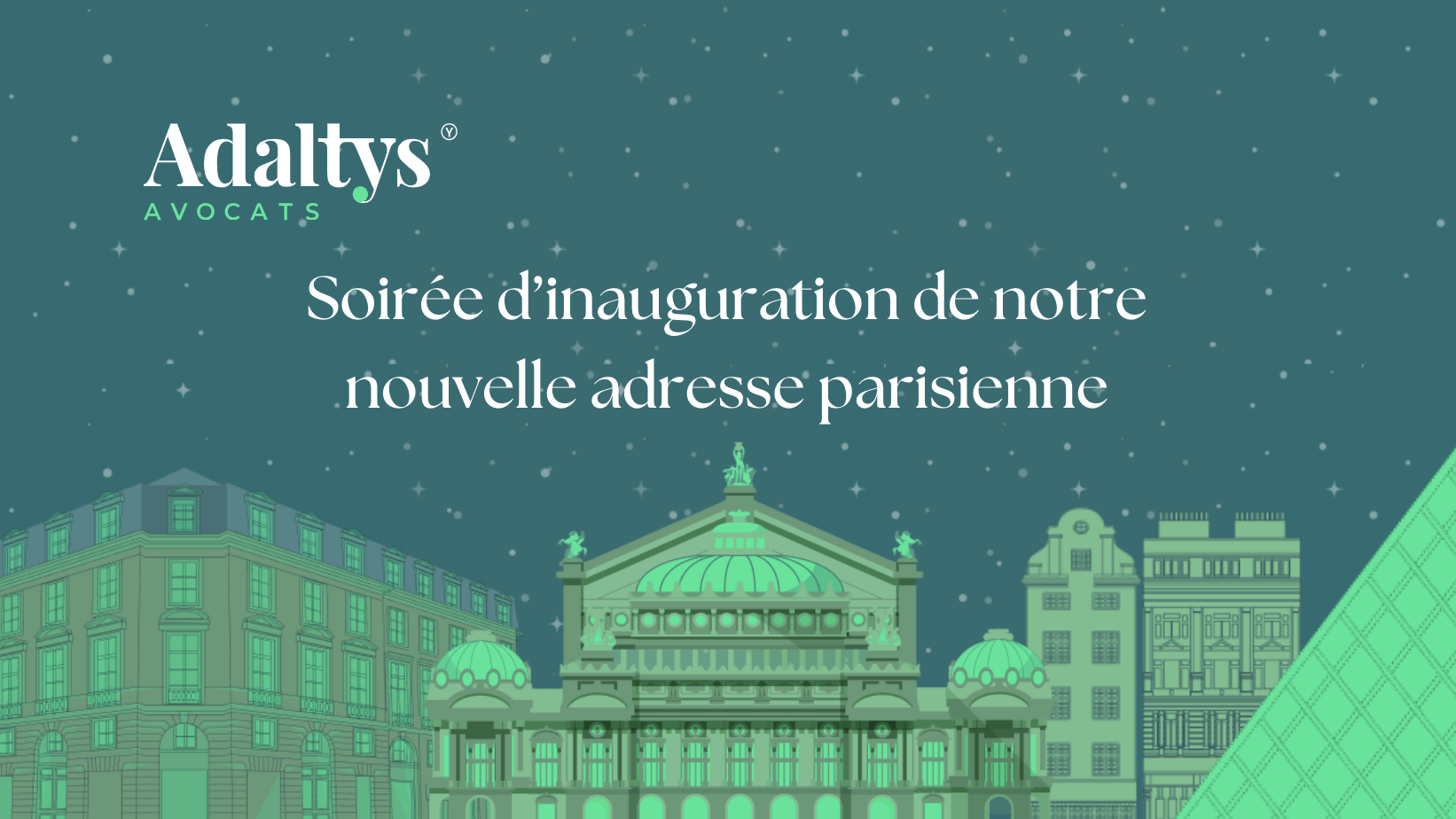Une semaine mouvementée dans la lutte contre la corruption…
La semaine a débuté sur des notes contrastées dans la lutte mondiale contre la corruption, avec la suspension du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) aux Etats-Unis et la publication de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024.
Le 10 février 2025, le président américain Donald Trump a signé un décret exécutif « Suspendre l’application de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger pour renforcer l’économie américaine et la sécurité nationale », suspendant, pour une période de 180 jours, l’application du FCPA.
Le lendemain, le 11 février, Transparency International a publié l’IPC 2024, qui évalue la corruption perçue dans le secteur public de 180 pays et territoires. La France chute à la 25ᵉ place du classement, reculant de 5 positions par rapport à l’année précédente, un score historiquement bas attribué aux scandales politico-financiers récents et à une érosion de la confiance dans les institutions démocratiques.
Les États-Unis, quant à eux, reculent de 5 places et se situent à la 28ème place du classement en raison de l’influence croissante des lobbyistes et de la perception d’un système judiciaire moins efficace dans la lutte contre la corruption.
François Valérian, président de Transparency International rappelle que “la corruption est une menace mondiale en constante évolution, qui ne se limite pas à freiner le développement mais constitue également une cause majeure du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits humains.“
Quelle est la portée de ce décret ?
La signature du décret du 10 février a entraîné la suspension de l’application du FCPA, une loi fédérale de 1977 destinée à lutter contre la corruption d’agents publics étrangers. Cette législation s’applique non seulement aux entreprises américaines, mais aussi aux sociétés étrangères ayant des liens avec les États-Unis.
Des ressortissants étrangers peuvent également être poursuivis en vertu du FCPA, sur fond de guerre économique, comme ce fut le cas pour Frédéric Pierucci, ancien cadre d’Alstom, arrêté en 2013 aux États-Unis dans le cadre d’une enquête sur des pratiques de corruption liées à la vente de turbines, et qui fut un véritable piège américain.
Dans la continuité de la politique de Donald Trump visant à renforcer la compétitivité des entreprises américaines sur la scène mondiale, le décret suggère que le ministère de la Justice pourrait désormais choisir de ne pas appliquer le FCPA aux citoyens et entreprises américaines si cela risque de les désavantager sur le plan concurrentiel. Ce décret reflète la vision du président américain, qui estime que « l’application actuelle du FCPA entrave les objectifs de politique étrangère des États-Unis ».
Le décret accorde au Procureur Général, Pam BONDI, une période de 180 jours (renouvelable) pour réévaluer toutes les enquêtes et mesures d’application du FCPA en cours et émettre des directives ou des politiques actualisées.
Pendant cette période, le ministère de la Justice (DOJ) ne doit pas ouvrir de nouvelles enquêtes ou mesures d’application, sauf si une exception individuelle est jugée justifiée par le Procureur Général.
Aux termes du décret, dès que les nouvelles directives ou politiques seront publiées, le Procureur Général devra déterminer si des actions supplémentaires, telles que des mesures correctives liées aux enquêtes et à l’application antérieure du FCPA, jugées « inappropriées », sont nécessaires. Dans ce cas, il prendra les mesures qu’il considèrera appropriées ou, si besoin, soumettra ces actions au président.
Il est difficile de savoir exactement quelles « mesures correctives » Donald Trump envisage pour les « enquêtes et mesures d’application antérieures de la FCPA » que le Procureur Général jugerait « inappropriées ».
Le ministère de la Justice pourrait-il renégocier les accords de règlement à l’amiable des entreprises ? Les personnes reconnues coupables d’infractions au FCPA pourraient-elles être graciées ou voir leur peine commuée par le président ?
Des questions cruciales qui seront à suivre de près.
Quelles sont les incidences du décret pour les entreprises françaises ayant une activité aux États-Unis ?
L’adoption du FCPA en 1977 a marqué un tournant décisif dans l’éthique des affaires à l’échelle mondiale, en raison de son extraterritorialité.
Cette législation permet aux États-Unis de poursuivre pour corruption publique toute personne physique ou morale, s’il existe un lien de rattachement entre l’infraction et le territoire américain. Dans la pratique, ce lien de rattachement est interprété très largement par les autorités américaines. Une simple transaction effectuée en dollar est, par exemple, suffisante pour entraîner l’application du FCPA.
Les entreprises françaises se trouvent ainsi soumises à des exigences strictes en matière de conformité aux règles anticorruption, tant pour leurs activités sur le sol américain que pour leurs transactions avec des entités américaines.
Malgré la suspension, il est important de souligner que la corruption d’agents publics demeure illégale, tant en application du FCPA (non abrogée par le Congrès) que d’autres législations que celles-ci soient fédérales ou internationales.
En outre, une suspension ne signifie pas un abandon des poursuites. Le délai de prescription des actes de corruption est de 5 ou 6 ans selon les dispositions du FCPA, ce qui signifie que les infractions qui se sont produites récemment ou qui se produiront au cours des prochaines années pourront être poursuivies en justice par la prochaine administration, qu’elle soit républicaine ou démocrate.
Cette mise en pause génère une incertitude juridique importante, notamment en ce qui concerne l’application des nouvelles règles. Les risques liés à la corruption à l’international demeurent élevés, et l’absence de clarté pourrait rendre leur gestion plus complexe. Certaines entreprises pourraient être tentées de relâcher leurs efforts de conformité, les exposant ainsi à des risques financiers, réputationnels et judiciaires.
Les entreprises françaises ayant une activité aux États-Unis devront donc rester prudentes, et cela d’autant plus que les modifications législatives à venir auront pour principal objectif de préserver les intérêts des entreprises américaines en vue de renforcer leur compétitivité.
Les groupes français devront maintenir des standards élevés dans la lutte contre la corruption pour se protéger des éventuels risques judiciaires aux États-Unis et continuer de se conformer aux autres législations toujours en vigueur, telles que la loi Sapin 2 ou le UK Bribery Act. Même si les autorités américaines n’exercent pas leur compétence sur une période de 180 jours, d’autres autorités sont toujours susceptibles de le faire.
Et après ?
La suspension du FCPA constitue un recul sans précédent dans la lutte contre la corruption. Cette mesure, à contre-courant des réglementations européennes CSRD et CS3D, génère de nombreuses incertitudes.
Toutefois, une certitude s’impose : cette décision vise avant tout à préserver les intérêts américains.
Cette pause, ne doit donc en aucun cas inciter les entreprises à assouplir leurs efforts en matière de lutte contre la corruption. Bien au contraire, il est crucial pour les entreprises françaises de maintenir une culture éthique solide et une vigilance continue afin de préserver leur intégrité et leur compétitivité sur les marchés internationaux.